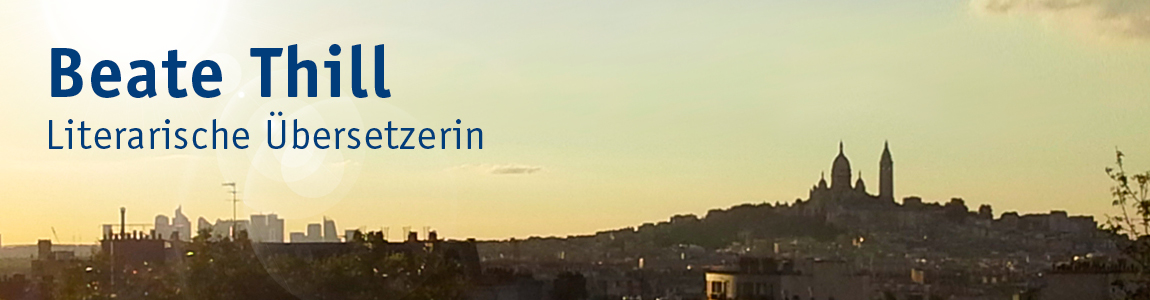Paris, 27.04.2025 Le Quai Branly vaut toujours une visite, ne serait-ce pour son jardin, féerique, ce matin d´un dimanche printannier.
Mais deux des expositions du Musée s´occupent de son „héritage lourd“, notamment des collections qui ont été ramassés pendant la periode coloniale.
L´éthnologie française, une science dont les débuts avec Marcel Mauss ne dataient que de 1925, avait dès 1931 envoyé une grande expédition de Dakar à Djibouti, la fameuse „Mission“ dont Marcel Griaule fut le directeur et Michel Leiris le scribe. Deux de ses ouvrages, devenus culte depuis, L´Afrique fantôme et Miroir de l´Afrique (Œuvres accompagnées de correspondances, textes et documents inédits) pourraient être utilisés comme le „procès-verbal“ de ce qui s´est passé pendant cette immense entreprise (Alice Diop).
La Mission avait mis deux années, parcourant Sénégal, Mali et l´intérieur du continent africain (l´ancienne Colonie „Soudan Français“), de ouest en est, avec un petit détour au Bénin et au Cameroun, pour arriver en Ethiopie et finir à Djibouti. Les 11 Européens avaient rapporté 3000 objets, on en voit une belle partie présentée dans les vitrines de l´expo actuelle. Dans le contexte colonial des années 1930, le focus des recherches ethnographiques de l´époque était sur les cultures africaines „censées disparaître rapidement sous l´effet de la colonisation“ et en même temps „d´enrichir la collection du Musée d´Ethnographie du Trocadéro à Paris.“
Apparemment, personne ne savait au préalable ce que le chercheurs allaient trouver. Dans une des premières vitrines on voit un livret avec les „Instructions sommaires pour les collecteurs d´objets ethnographiques.“ „La Mission l´avait publié juste avant son départ et allait le distribuer aux fonctionnaires coloniaux en chemin.“
Dans les vidéos qui accompagnent l´expo, parcontre, on voit des experts africains comme Daouda Kéita, directeur du Musée National du Mali, ainsi que son prédecesseur, Salia Malé, chercher, avec une ironie fine, le mot juste pour les „acquisitions“. Pourrait-on désigner cette prédation pure et dure du mot de „cadeaux forcés“? Avec Mame Magatte Sene Thiaw et autres, ces personnalités sont les commissaires associés à „la Contre-Enquête“ (ainsi le titre de l´expo) sur la Mission de 1931 à 1933.
Le Musée du Quai Branly, avec Gaëlle Beaujean qui s´occupe des collections d´Afrique, a pris l´initiative de s´acquitter de la question des réstitutions d´abord par cette entreprise collective de recherches sur place, effectuées par les spécialistes des pays africains concernés. Ce procès commencé en 2021 pourrait devenir un modèle pour le travail autour des restitutions en Europe, qui sont d´ailleurs un thème très controversé en Allemagne.
Les vidéos montrent les recherches récentes dans une trentaine des villages africains qui avaient été visités par Griaule et ses hommes il y a 90 ans. On voit les commissaires de l´expo actuelle qui présentent les photos des objets aux représentants des cultes de nos jours.
Dans un village du Mali il s´agissait du „rapt“ d´un objet qui assurait la protection de la communauté. La mémoire était encore vive puisque les grands-parents avaient raconté l´évènement aux générations suivantes.
Même expérience dans le sanctuaire du Kono, à Diabougou (Mali) où Leiris avait aidé à voler des objets de culte puissants. Aujourd´hzi, il ne reste qu´une arche de ce sanctuaire. Le descendant des chefs du culte dit qu´ils avaient repris la prière quand ils avaient vu les photos des objets dans les journaux. Questionné sur la mémoire du rapt il pèse ses mots: „Ils ne sont pas rentrés pour voler mais ils ont pris par la force.“
Voyant des photos d´objets pour la protection des jumeaux, les „sika“, le petit-fils d´un propriétaire, lui-même très agé, garde longtemps le silence, pour dire enfin: „Là-bas, ils n´ont pas seulement les photos, ils ont les objets eux-mêmes …Ils ont exercé la force sur le Noir.“
Si on a lu Leiris, on se rappelle de la mauvaise conscience que l´auteur note dans ses écrits, mais tout marchait sans encombre. Finalement, les colonisés n´aillaient pas faire une révolte á cause de la prise de ces objets.
Dans une autre vidéo on voit la cinéaste française Alice Diop (Saint Omer) en entretien avec la commissaire générale, Gaëlle Beaujean. Elle était sur le pont de préparer un film de fiction, une adaptation de L´Afrique Fantôme, au moment où elle avait pris contact avec le projet du Musée. C´est elle qui met les points sur les i quand elle parle de ses intentions: une contre-archive qui informe sur ce que Leiris et ses compagnons n´avaient pas vu ou omis de leur reportage, une réparation du regard, souvent folclorique dans les films d´anthropologie, de préferer, au regard surplombant, plutôt les témognages du quotidien de rituels qui subsistent, filmés par ceux qui les partagent. Et Alice Diop nomme la contre-enquête une „restitution-papier“ dont elle loue l´ouverture d´esprit.
En 1933, 2500 objets rapportés par la Mission sont présentés au Musée d´Ethnographie du Trocadéro …